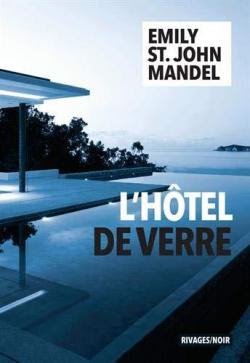Présentation éditeur
« Et si vous avaliez du verre brisé ? » Comment cet étrange graffiti est-il apparu sur l’immense paroi transparente de la réception de l’hôtel Caiette, havre de grand luxe perdu au nord de l’île de Vancouver ? Et pourquoi précisément le soir où on attend le propriétaire du lieu, le milliardaire américain Jonathan Alkaitis ? Ce message menaçant semble lui être destiné. Ce soir-là, une jeune femme prénommée Vincent officie au bar ; le milliardaire lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie. D’autres gens, comme Leon Prevant, cadre d’une compagnie maritime, ont eux aussi écouté les paroles d’Alkaitis dans ce même hôtel. Ils n’auraient pas dû…
Ce que j'en pense
J'aime aborder la plupart de mes lectures sans savoir grand-chose, et parfois, comme ça a été le cas ici, je connais juste le point de départ : cet hôtel luxueux pour riches en mal de sérénité, la phrase inscrite sur la baie vitrée de l'hôtel. Et c'était très bien ainsi, parce que je ne savais pas où m'emmenait Emily St. John Mandel, et vous le savez, elle s'y entend pour nous promener et instiller un climat d'étrangeté.
C'est un roman fascinant, qui crée un sentiment de décalage alors qu'il traite d'un sujet contemporain dont d'autres feraient un machin plat et terre-à-terre. On se laisse porter, égarer, et la romancière retombe sur ses pattes à la fin (par rapport à l'inscription) avec une élégance folle, une absolue maîtrise de l'architecture de son récit. On referme le roman habité par des scènes, des images, des phrases, et c'est tout bonnement somptueux. On passe d'une année à l'autre, d'une strate temporelle à l'autre, de la vie à la contrevie (lisez et vous comprendrez), et ce n'est jamais confus (pas comme certaine mini-série britannique regardée par un dimanche soir de déprime, totalement fouillis et ch...). Emily St. John Mandel est une grande romancière.
Nous vivons tous dans cet hôtel de verre, et nous sommes cruellement rattrapés par les ignominies commises, par la cupidité, par l'escroquerie généralisée du capitalisme financier. J'ai parfois pensé au film Margin Call de C.J. Chandor : ces gens brassent des millions et des milliards qui en fait n'existent pas, mais qui s'évaporent et anéantissent des vies. Telle est l'escroquerie suprême : construire un système sur de l'argent pour ainsi dire virtuel. Voilà l'hôtel de verre. Et il se brise à un moment ou à un autre.
Il y a des évocations saisissantes de l'Amérique invisible, ou des invisibles (magnifique personnage de Leon). Comme toujours avec St. John Mandel, c'est subtil, anti-démonstratif (avec les pesanteurs qu'on pourrait y mettre), c'est presque onirique et pourtant glaçant.
L'hôtel de verre est un roman somptueux, tout simplement.
Emily St. John Mandel, L'hôtel de verre (The Glass Hotel), Rivages Noir, 2021. Traduit de l'anglais (Canada) par Gérard de Chergé.