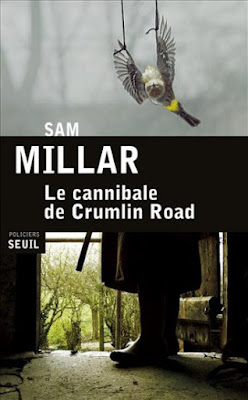Présentation (éditeur)
Dominique, cambrioleur indépendant, aime les coups efficaces et sans risques. Malheureusement il doit une grosse somme à deux truands qui veulent sa peau. Acculé, il prend un billet pour Los Angeles où il compte retrouver son pote Kenny, devenu "producteur" à Hollywood. En fait, Kenny monte des projets de films bidons dans le but d'arnaquer des financiers trop crédules. Dominique tombe à pic : il est aussitôt recruté pour jouer le rôle d'un faux réalisateur. A Hollywood, tout est possible, surtout le pire, car l'usine à rêves est avant tout une fabrique de cauchemars.
Ce que j’en pense
J’avais envie de confirmer l’impression résultant de ma lecture du dernier opus de Dominique Forma, Amor. Hollywood Zéro n’a pas la même ampleur, me semble-t-il, mais j’ai passé un excellent moment, avec un polar parfaitement maîtrisé, au rythme impeccable. C’est lorsque le personnage s’envole pour les Etats-Unis que le livre prend tout son intérêt pour moi: je ne sais pourquoi, la partie parisienne du début m’a moins intéressée. Mais ensuite, mazette! quel rythme, quelle tension! Mais pas de cette tension factice qui me fatigue dans les thrillers, non, là on reste dans du noir, avec des personnages en demi-teinte, un mélange d’action et d’attente… J’ai aimé le dénouement, là aussi on est dans du noir, juste ce qu’il faut.
Dominique Forma a un talent évident pour poser les personnages et les faire exister en quelques phrases, tout en les faisant évoluer pour révéler leur complexité. Outre le narrateur, as de la cambriole qui va de déconvenue en déconvenue, il y a Kenny mais surtout, il y a Rachel, superbe personnage féminin, tout en fêlures, et qui échappe aux clichés habituels (même si le narrateur jouera les vengeurs pour elle).
Enfin, Dominique Forma, qui connaît Los Angeles, s’y entend pour croquer des scènes, des lieux, l’envers du rêve américain: la scène du Bastille Day, l’évocation du Gershwin Hôtel, toute une faune oubliée de la réussite hollywoodienne… C’est saisissant, et jamais le regard posé sur eux n’est cynique ou sarcastique.
Bref, si Hollywood Zéro n’est pas le choc qu’a été pour moi Amor, c’est un excellent roman noir, et assurément, je vais poursuivre ma découverte de cet auteur.
Dominique Forma, Hollywood Zéro, Rivages/Noir, 2014. Disponible en ebook.