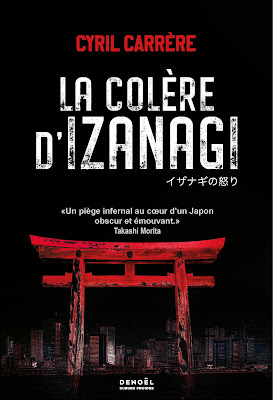Présentation éditeur
À la frontière des Alpes italiennes et françaises, le village de Tordinona est l’isolement incarné. Voyant la tempête qui se prépare là-haut, la patrouille de gendarmerie composée de Marcus et Nadia s’apprête à redescendre dans la vallée quand le garde champêtre découvre le corps de la fille du maire. Dès le lendemain, alors que le seul pont reliant Tordinona au reste du monde a été détruit par une avalanche, le maire et une partie des habitants s’en prennent à un voyageur de passage qu’ils soupçonnent d’être l’assassin. Attachés à leur devoir, Nadia et Marcus s’opposent à leur haine et à leur désir de se faire justice ; dès lors ils s’apprêtent à lutter contre eux. Dans ce huis clos enserré par la violence des éléments, la tension ne cesse de monter, et avec elle, une question qui traverse les âges : que reste-t-il de notre humanité quand il n’y a (presque) plus personne pour faire respecter la loi ?
Ce que j'en pense
Alors c'est bien simple, j'ai lu ce roman en une journée : je l'ai commencé à la pause café du déjeuner, et je l'ai terminé le soir. Sébastien Vidal parvient à allier une écriture poétique, qui capte la violente beauté d'une nature déchaînée, et une tension narrative rapidement installée, qui vous fait tourner les pages avec avidité. La référence qui s'impose est Délivrance, roman de James Dickey adapté par John Boorman en 1972. Mais j'ai également pensé au film de Tarantino, Les Huit Salopards (2015), pour le mélange entre western et épouvante sur fond de tempête de neige.
Sébastien Vidal a un talent fou pour évoquer la nature et sa furie. Il fait ressentir le déchaînement de la neige et du vent, donne à voir les flocons dans leur variété, les hurlements du vent. Et pour qui a déjà fait l'expérience terrifiante d'une tempête, sa façon d'évoquer le craquement d'un arbre qui cède sous les assauts des éléments déchaînés rappelle de cruels souvenirs.
Pour le reste, il pose une sorte d'hypothèse : prenez une petite communauté naturellement isolée, dans la montagne, dans une zone blanche, introduisez des circonstances exceptionnelles (la tempête et un meurtre), amenez un élément extérieur (un voyageur de passage), secouez tout ça. Les esprits chagrins, ou idéalistes, diront : "rhôô, meuh non, c'est pas réaliste". D'abord, ce n'est pas le problème, le questionnement de Sébastien Vidal est ailleurs. Ensuite, ne sous-estimons pas l'effet de meute qui ramène très vite à l'animalité, aggravée peut-être par les raisons que l'on se donne pour laisser déferler la violence.
Ainsi, Sébastien Vidal teste les limites de ses villageois dont on sait d'emblée qu'ils sont étroits d'esprit (leur accueil des "hippies" de la ferme pose bien l'ambiance) et racistes. L'isolement procure un sentiment d'impunité, l'effet de meute décuple d'emblée la violence pulsionnelle. Alors qu'en ouvrant le roman, on pense lire un récit d'enquête, on bascule dans l'épouvante.
L'auteur n'est pas manichéen : il excelle à montrer les douleurs intimes, celle du père, ce tout-puissant maire et notable qui donne du travail à la communauté, celle du gendarme, qui n'en finit d'expier une "faute" qui elle aussi, résulte de son animalité et de l'instinct de survie. Parce que la douleur est immense, la raison ne tient plus, et toutes les digues cèdent, semant cadavres et destruction. La peur est mauvaise conseillère : il faudrait le rappeler aux puissants de ce monde, ne jouez pas aux apprentis sorciers en agitant (et en créant) des peurs dont vous ignorez ou feignez d'ignorer les conséquences terribles. Ici, la haine se nourrit de la peur de l'Autre, celui qui n'est pas né au pays, celui qui vient d'ailleurs. S'il est un peu basané, c'est évidemment pire.
Les personnages sont somptueux : le trio retranché, bien sûr, mais aussi le maire, dans sa folie et sa douleur, le garde-champêtre, et deux personnages dont je ne dirai rien ici, mais qui ont la mémoire des folies destructrices, des meutes meurtrières, hantés par leurs propres fantômes.
En somme, De neige et de vent joue avec des conventions génériques mêlées (noir, western, épouvante) mais sans donner dans le vain exercice de style. Avant tout, De neige et de vent est un superbe roman noir, tragique et social, qui à partir d'un moment hors-normes, d'un instant de pur excès, questionne sur la banalité du mal.
Sébastien Vidal, De neige et de vent, Le Mot et le Reste, 2024.